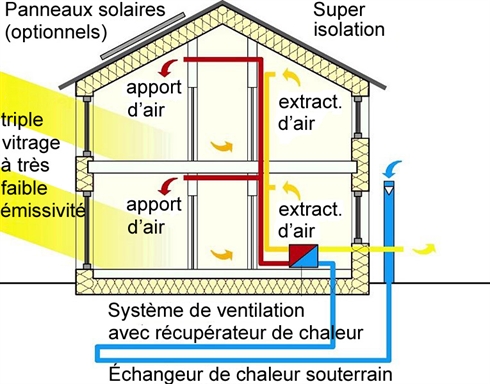dans la culture du projet architectural
En 2008, nous célèbrerons le centenaire d’un article d’Adolph Loos, «
Ornement et Crime », qui peut marquer le début d’une aventure ou nous sommes encore, celle de l’Architecture Moderne (AM™)
[1] et de ses avatars contemporains.
L’AM™ se signale par une volonté de rupture avec l’histoire de
l’architecture. A minima, il se délie de son passé immédiat,
l’éclectisme architectural du XIX
ème siècle. De façon plus radicale, certains tenants de l’AM™ veulent «
du passé, faire table rase ». Le spectre de la «
table rase » a hanté la pratique architecturale, de 1910 à 1960.
Mais l’AM™ est, dès ses origines, rattrapé par l’histoire, de plusieurs façons :
•
Pour se dégager de la période précédente, l’AM™ utilise certaines méthodes de la période précédente, et en particulier, la référence à de «
bons exemples » antérieurs. Simplement, ce ne sont pas les mêmes «
bons exemples », ou ce n’est pas le même regard sur les «
bons exemples ». Adolph Loos préfère les maisons paysannes du XIX
ème siècle, plutôt que ses palais. Le Corbusier admire les «
châssis » romains, quand d’autres, avant lui, ne voyaient que leurs «
carrosseries »
[2].
•
Pour valider son existence et asseoir son hégémonie sur le siècle,
l’AM™ se trouve des ancêtres respectables, il s’invente une généalogie
comme un patricien romain prétend descendre d’Enée. En 1933, Emil
Kaufmann écrit «
De Ledoux à Le Corbusier », il y traite des «
origine et développement de l’architecture autonome » en partant de trois architectes de la fin du XVIII
ème siècle : Ledoux, Boullée et Lequeu. En 1960, Leonardo Benevolo écrit une «
Histoire de l’architecture moderne », considérée comme la fille légitime de la révolution industrielle. En 1968, Nikolaus Pevsner écrit «
Les sources de l’architecture moderne et du design »,
qui annexe l’Art & Craft anglo-saxon, l’expressionisme allemand, le
modernisme catalan, l’art nouveau belge et français. Il faut lire ces
ouvrages avec intérêt, sans perdre de vue l’intérêt des auteurs, ardents
propagandistes de l’AM™ : ils écrivent l’histoire en toute rigueur,
mais insistent lourdement sur ce qui sert leur cause.
•
Pour perpétuer sa geste héroïque après qu’il a triomphé,
l’AM™ fait référence à sa propre histoire. Fondé sur la table rase et
la réinvention permanente, sur le refus de la copie, il se copie
lui-même à partir des années quarante du siècle dernier.
•
Pour surmonter ses crises, l’AM™ réintègre les pans
d’histoire qu’il avait d’abord rejetés, dans d’affligeantes cérémonies
d’auto-flagellations, menées par le
Team Ten des années
soixante, par le régionalisme critique italien et suisse, par le
postmodernisme américain et français, par l’historicisme des années
soixante-dix.
Au terme de si nombreuses conquêtes et de si nombreuses repentances,
tout ce qui a été bâti depuis le début de l’humanité a droit de cité
dans la «
culture du projet » contemporain. Nous avons à dire en quels termes il y a droit.
Si on devait écrire l’histoire de l’architecture telle qu’elle sert
aux architectes contemporains, il faudrait, en toute rigueur, s’engager
dans un processus régressif, qui prendrait pour origine la pratique
actuelle de l’architecture, et qui remonterait le temps, autant que de
besoins actuels. C’est ainsi qu’on fouille les ruines, des couches les
plus récentes aux strates les plus profondes. Á rebrousse temps, il
faudrait systématiquement mettre les effets en avant des causes. La
fouille ferait fouillis…
Par soucis de clarté, ce cours de première année se contera de
l’ordre chronologique, à partir de la Renaissance, parce que c’est à
partir d’elle que les architectes s’emparent consciemment de l’histoire,
comme matière première de leur travail. Chemin faisant, les périodes
antérieures à la Renaissance seront évoquées aux moments où elles seront
convoquées par les architectes, du XV
ème siècle à nos jours. Cela sera fait avec un peu d’approximation, pour aller vite et pour fixer des repères
[3]. Cela ne dispense pas de la lecture des bons auteurs.
1400 – la Renaissance et le Panthéon de Rome
Dès le début du XV
ème siècle, on parle en Italie de
Rinascita des arts et des lettres
[4]. Mais les historiens actuels ne s’accordent ni sur les dates de la Renaissance
[5], ni sur l’importance de la césure avec le Moyen-âge. Les humanistes de la Renaissance s’inspirent de ces «
vieux romains
» qui, au contact des grecs, ont apprit un peu de poésie et de
philosophie. Les humanistes connaissent assez bien les textes latins.
Mais ils en savent beaucoup moins de l’architecture romaine. Á Rome, ils
peuvent voir les ruines de nombreux monuments. Mais la maison romaine
reste une énigme. Pour la résoudre, ils n’ont encore que des fragments
épars, un ouvrage de Vitruve
[6], sans dessins, et deux lettres de Pline le Jeune
[7]. Les architectes vont devoir réinventer la maison romaine, qu’ils ne voient pas. Et parce qu’ils sont «
des nains juchés sur des épaules de géants »
[8],
éclairés par le message du Christ, ils auront à réinterpréter ce qu’ils
voient trop bien, le génie païen qui s’incarne au temple de tous les
dieux, le Panthéon de Rome, encore entier.

Panthéon de Rome, photo Ben Madeska Brunelleschi, sacristie de San Lorenzo
Filippo Brunelleschi (1377-1446) est le premier architecte de la
Renaissance. Il visite Rome une première fois de 1404 à 1406. Il y
reviendra régulièrement. Il est humaniste. Il cherche la perfection. Il
imagine l’Homme au centre de l’Univers. Il espère un plan centré, où
l’Homme se tiendrait. Mais l’homme qui visite le Panthéon doit se casser
le dos pour voir ensemble l’oculus de la voute, au centre, et la niche
qui se creuse, en fond de scène. Á la Sacristie de San Lorenzo, achevée
en 1428, Brunelleschi imagine une niche plus profonde, une petite
chapelle analogue au volume principal : même coupole, même structure ;
mêmes matériaux. Le Christ y est mis en croix, et en reflet de l’homme
qui se tiendrait au centre de la pièce principale, si un sarcophage ne
l‘encombrait pas.
 Plan en double carré… Plan recentré, Brunelleschi, Chapelle Pazzi
Plan en double carré… Plan recentré, Brunelleschi, Chapelle Pazzi
Á la chapelle Pazzi, commencée en 1430, Brunelleschi ne se contente
plus de ce dispositif. Le plan en double carré de San Lorenzo,
satisfaisant d’un point de vue perspectif, privilégie l’axe
longitudinal, au détriment de l’axe latéral. Pour les Pazzi,
Brunelleschi redonne de l’ampleur à l’axe latéral, il rééquilibre les
volumes, il recentre le plan. Il s’inspire des romains. Mais il invente
une nouvelle architecture.
1500 – le Maniérisme et la villa d’Hadrien
Le «
maniérisme » est d’abord utilisé, dans un sens
péjoratif, par un archéologue et historien d’art italien, l’abbé Lanzi
(1732-1810). Les historiens du XX
ème siècle imposent le «
maniérisme » pour désigner la Renaissance tardive (1520-1600). Ainsi, les architectes «
maniéristes » ne savaient pas qu’ils l’étaient. Ils savaient seulement qu’ils travaillaient «
à la manière
» de la génération précédente, avec l’affectation blasée de ceux qui
ont déjà joué, et vu jouer, de nombreuses parties antérieures. On
travaille d’abord «
à la manière » des anciens, et ensuite, «
on fait des manières »… comme Jules Romain, au Palais du Té de Mantoue (1526-1534).

Maquette de la Villa Adriana
Les nouveaux joueurs en savent un peu plus long sur les romains. Les «
antiquaires
», amateurs et pilleurs d’antiques, s’y emploient avec obstination. En
1506, on exhume le Laocoon, torturé par les serpents. En 1549, le
cardinal d’Este appelle un peintre, Girolamo Sellari (1501-1556), pour
remettre au jour la villa Adriana, près de Tivoli. L’empereur Hadrien y
avait regroupé et assemblé, au premier siècle après Jésus Christ, des
parties bricolées «
à la manière » des architectures qu’il
avait aimées au cours de ses nombreux voyages. Le site était déjà connu à
la première Rnaissance. Mais il se révèle, de plus en plus clairement,
comme une fantaisie, comme une «
folie » que les «
vieux romains » auraient désavouées, s’ils avaient eut à la connaitre. Hadrien n’était pas un «
vieux romain ». Il fallait des «
renaissants tardifs » pour le comprendre, et utiliser le fatras désarticulé que Michel-Ange avait déjà pressenti.
 Michel-Ange, Bibliothèque Laurentienne, 1519
Michel-Ange, Bibliothèque Laurentienne, 1519
Sculpteur, peintre, architecte, Michel-Ange (1475-1564) n’est pas à
proprement parler maniériste. C’est un monstre solitaire. Il n’est pas
né quand la Renaissance commence. Il est mort avant l’avènement du
Baroque. Mais rien, ni avant, ni après, n’aurait pu être compris sans
lui. L’entrée de sa Bibliothèque Laurentienne dit tout du maniérisme. De
prime abord, c’est une architecture de la Renaissance : colonnes ;
entablements, etc. De plus près, tout parait détourné de sa fonction
première : les colonnes sont profondément engagées dans les murs, au
lieu d’être en saillies ; les pilastres qui flanquent les fausses
fenêtres s’évasent en hauteur ; et cet escalier… il parait envahir la
pièce et entraver tout autre mouvement que le sien. Les parties
paraissent en concurrence perpétuelles, comme sont les éléments
assemblés dans la villa Adriana. Le monde parfait des humanistes
s’éloigne à jamais.
1600 – le Baroque et les Catacombes
Le «
baroque » peut venir du portugais «
barrueco », qui désigne une perle irrégulière, ou du vieil italien «
baroco », qui qualifie les syllogismes de faibles contenus. Dans un cas comme dans l’autre, le terme est péjoratif. Le «
baroque » est fondé comme catégorie esthétique par l’historien d’art Heinrich Wölfflin (1864–1945) dans son livre «
Renaissance et Baroque
». Comme les maniéristes, les architectes baroques ne savent pas ce
qu’ils sont. Ils poursuivent l’œuvre classique, en la compliquant encore
un peu plus que les maniéristes. Ils sont au service de princes
farouches. En 1517, Augustin Martin Luther apposait 95 thèses contre les
indulgences sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg.
C’était la Réforme protestante. En 1545, le Pape Paul III convoque le
Concile de Trente, qui durera 18 ans. C’est la Contre-réforme. Après
qu’on a tempéré les ardeurs du Turc, à Lépante, en 1571, on peut
joyeusement se massacrer entre chrétiens. Les papes et les Rois Très
Catholiques veulent en remontrer aux pisse-froids protestants ; l’Église
doit déployer tous les fastes de sa pompe, et toute la rigueur de son
glaive, de la lumière la plus vive à l’ombre la plus noire.
 Catacombes de Domitille, Rome
Catacombes de Domitille, Rome
Une face cachée du christianisme est découverte par hasard. En 1578,
tandis que des travaux sont entrepris près de la via Salaria, le sol
s’effondre et révèle un cimetière souterrain. La trouvaille attire des
milliers de curieux. Mais il faut attendre une vingtaine d’année pour
qu’Antonio Bosio, qui pénètre pour la première fois dans une catacombe
en 1593, en explore tous les méandres, dans le clair-obscur des torches.
Quand même ces découvertes sont sans rapports directs, ni avec l’église
du Gésu de Rome (1584), premier édifice de la Contre-réforme, ni avec
les circonvolutions elliptiques que mènent à leurs apogées Le Bernin
(1598-1680) et Borromini (1599-1667), les mêmes lueurs vacillantes
éclairent, à nos yeux, les catacombes et les chefs-d’œuvre baroques.

Guarini & Juvarra, église Sant’Andrea, Turin, 1700
Camillo Guarino Guarini (1624-1683) et Filippo Juvarra (1678-1736)
vont se succéder pour réaliser l’église Sant’Andrea de Turin. Dans
chacune des chapelles, des portes s’ouvrent vers d’autres chapelles,
instaurant partout un effet labyrinthique, parfois magique, souvent
grotesque, au sens propre du terme : les lumières dorées, les courbes
concaves et convexes du baroque sont celles d’une grotte. C’est dans
l’air d’un temps inquiet, qui se donne des airs de triomphe.
1700 – le Classicisme et le Parthénon d’Athènes
L’architecture inspirée des anciens est désignée comme «
classique » depuis le XVI
ème siècle. Le «
classicisme » désigne, depuis le XIX
ème siècle, une réaction aux mouvements baroques, un raidissement observé en France à partir du milieu du XVII
ème siècle. Á la fin du XIX
ème siècle, on désigne comme «
néoclassique »
tout ce qui s’apparente de près ou de loin à cette raideur nouvelle :
l’œuvre de Palladio (1508-1580), dont le maniérisme est fortement
tempéré, aussi bien que le retour aux fondamentaux grecs, dans les pays
anglo-saxons du XVIII
ème siècle. Sans nuance, on mettra dans
le même sac tout ce qui part de France, vers 1650, et qui s’achève aux
États-Unis, vers 1850. C’est la période des États-Nations. Les petites
cités italiennes passent la main aux grands royaumes. Les affaires
sérieuses se traitent dans les grandes capitales. Louis XIV (1638-1715),
Roi Absolu, a voulu des arts absolument français. Il créé des
académies. Pierre Puget (1620-1694), petit marseillais, grand sculpteur
et excellent architecte, en fait les frais en passant : à Marseille et à
Gênes, il travaille dans le genre baroque ; il monte à Versailles et on
le présente à la Cour ; il sent l’ail, il est de genre italien, quand
c’est le goût français qui doit être imposé ; il est chassé ; une de ses
statues traîne encore au Louvre.

Le Parthénon d’Athènes
Instaurer un art français, ce serait en finir avec les italiens, en revenir aux fondamentaux, aux «
vieux romains »
et mieux encore, à la Grèce éternelle. Mais la Grèce est gouvernée par
les turcs, qui se méfient des étrangers. De trop rares voyages y sont
organisés. Le marquis de Nointel, ambassadeur de Louis XIV auprès la
Sublime Porte de 1670 à 1679, passe de longs moments en Grèce avec
Antoine Galland, orientaliste distingué. En 1674, privilège insigne, il
est autorisé à visiter l’Acropole. Il en repart ébloui. Des anglais,
Spon et Wheler, vont suivre en 1676. Au début du XVIII
ème
siècle, l’empire Ottoman, affaibli sur tous les fronts, va relâcher sa
surveillance, et tout ce que l’Europe compte de beaux esprits va se
précipiter en Grèce. La plus grande facilité des voyages n’explique pas
tout. Le regard de l’Europe s’est aiguisé. Une part importante des «
antiques »
qu’on peut voir en Grèce nous vient de la période hellénistique, ou
d’après la conquête romaine. Au premier siècle avant, et au premier
siècle après J.C., les élites parlent grec et latin, elles pensent en
latin et en grec, dans tout l’empire. Découvrir la Grèce, c’est
apprendre à voir et à distinguer cette petite part de la culture grecque
qui a précédé l’empire. En un mot, c’est voir le Parthénon, resté en
assez bon état jusqu’à ce que les vénitiens l’explosent
[9] et que les anglais le pillent
[10].
Peu importe ces dégradations. Ce que peuvent voir les européens, ce
qu’ils auraient pu voir aussi bien à Paestum ou à Ségeste, c’est
l’ampleur d’une cabane primitive portée à la dignité d’un temple
olympien. Ces colonnes immenses et déliées des murs, pour les voir, il
faut en passer par la colonnade du Louvre, et ce qu’on vit à Athènes ne
fut pas forcément ce que les grecs croyaient en montrer.
 Le Bernin, projet pour le Louvre
Le Bernin, projet pour le Louvre
 Perrault, colonnade du Louvre
Perrault, colonnade du Louvre
Tandis que Versailles est agrandi (1661-1670), le Roi fait reconstruire l’aile orientale du Louvre.
Le Bernin est invité à Paris. Il propose un dessin. C’est colossal !
Mais c’est italien ! Le Bernin est aimablement prié de rentrer chez lui.
Claude Perrault (1613-1688) prend le relai. Il dessine une nouvelle
façade en 1665. Si le Bernin a offert à la France l’ordre colossal des
colonnes, Perrault délie les colonnes de la façade, il la creuse. Il
n’est pas le premier, mais personne ne l’a encore fait aussi clairement.
Et personne n’expliquera mieux que Laugier (1713-1769) pourquoi une
cabane primitive ou un temple archaïque valent mieux que toutes les
manières qui en découlent. «
Rien n’est peut-être véritablement compris en Europe tant que cela n’a pas été expliqué par un Français »
[11].
C’est par la France que l’Europe aura été préparée à voir les pures
colonnes de la Grèce antique, plus parfaitement déliées des murs et des
détails que Perrault n’aurait su le faire. Le néoclassicisme s’ensuit
mécaniquement.
1800 – le Romantisme et le Temple de Louxor
Le «
roman » moderne s’annonce comme une fiction intriquée à
la trivialité du langage et des situations. Après Rabelais (1494-1553)
et Cervantès (1547-1616), l’extraordinaire, l’étrange, le merveilleux,
le sublime, le tragique, ne sont plus détachés de la réalité ; ils en
viennent, ou ils y reviennent
[12]. Ce qui s’apparente à ce genre littéraire est «
romantique » depuis la fin du XVII
ème siècle. Le «
Romantisme » désigne, aux XVIII
ème et XIX
ème
siècles, un courant intellectuel et artistique conscient de cette
intrication entre le réel et l’imaginaire. Le sujet y est jouissant,
souffrant, aussi saignant que le fils de l’homme a pu l’être, et tout
uniment, ce que son imagination voudra qu’il soit, dans les hautes
sphères ou dans les bas-fonds. Un jour, Lamartine se désespère au bord
d’un Lac –
« Ô temps ! suspends ton vol » et tout ce qui s’ensuit – un autre jour, il mouille la chemise tout contre les insurgés de 1848. C’est le même Lamartine. Prétendre que le XIX
ème
siècle est essentiellement romantique, que le siècle des révolutions
nationales, démocratiques, industrielles, coloniales, est suspendu aux
lèvres des poètes, n’est ni plus ni moins caricatural que de parler d’un
siècle de la Renaissance, du Maniérisme, du Baroque ou du Classicisme.
Le XIX
ème est le siècle du romantisme parce que c’est le
siècle des révolutions. Ce sont les mêmes, qui chantent la Marseillaise
et qui guillotinent les marseillais, qui révèrent l’Orient Mystérieux et
qui fusillent les orientaux, qui pleurent aux malheurs des pauvres et
qui affament le peuple. En toute conscience,
aux noms des hommes,
les militants révolutionnaires, les capitaines d’industries et les
généraux d’empires ferment le ban que les condottières de la Renaissance
avaient ouvert
au Nom de l’Homme.
 Louxor, David Roberts, 1839
Louxor, David Roberts, 1839
Dès lors que les hautes sphères de la beauté ne sont plus déliées du
monde réel, on peut voir et aimer, pour leurs imperfections, les abbayes
romanes et les cathédrales gothiques que la Renaissance avait rejetées à
cause de leurs imperfections. L’homme romantique peut aimer les fermes
de la Beauce et les villages de Provence, les jardins chinois et les
maisons japonaises, les temples indiens et les pyramides aztèques, les
églises byzantines et les Yalis turcs. Au grès de ses conquêtes, il aura
une tendresse toute particulière pour les langueurs orientales.
L’Egypte que découvrent les nombreux visiteurs de la fin du XVIII
ème
siècle, l’Egypte que foulent aux pieds les troupes napoléoniennes
engagées, de 1789 à 1801, dans une calamiteuse expédition, l’Egypte que
les savants, diligentés par l’Empereur, étudient avec rigueur et
passion, n’est pas, au sens strict, «
l’Égypte des pharaons ».
C’est l’animation des rues du Caire, c’est la vie quotidienne aux bords
du Nil, et c’est, en fond de scène, les temples, les palais et les
tombeaux abandonnés, ensablés, démembrés, grandioses
et pittoresques, sublimes
et
incarnés. L’éclectisme, qui désigne l’égale légitimité de tous les
styles que les artistes voudront adopter, de toutes les architectures
que les architectes pourront imiter, de toutes les sources
d’inspirations subjectives, est la version pratique du romantisme, des
liens nouveaux entre la réalité et la fiction.


Karl Friedrich Schinkel, Bains romains, Potsdam
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) peut être, aussi bien,
néoclassique à la ville, et pittoresque à la campagne. Ses sources
viennent, parfois de l’architecture gothique, souvent d’une campagne
romaine idéalisée, dont les treilles nous invitent à la sieste ou à une
coupe de vin frais. Assez régulièrement, il instaure une étroite
complicité entre un plan unitaire, abstrait, et un fourmillement
pittoresque. Á Berlin, derrière une colonnade unitaire, les volumes du
Vieux Musée sont creusés de façon plus complexe que ce que Perrault
aurait pu imaginer. Á Postdam, les Bains Romains apparaissent, de loin,
comme un jeu de volumes variés au dessus d’un soubassement horizontal
unitaire, et de plus près, comme une découpe complexe creusée sous la
treille horizontale. C’est l’effet de ses voyages en Italie. C’est aussi
un souvenir de jeunesse : en 1797, Schinkel visite l’exposition d’un
projet de Friedrich Gilly (1772-1800) ; c’est un fatras
gréco-romain-égyptien –
temple, statues, obélisques – installé sur une large assise abstraite ; vivement impressionné, l’adolescent décide ce jour là de devenir architecte.
1900 – Frank Lloyd Wright et le romantisme
La fin XIX
ème siècle et le début du XX
ème
siècle sont marqués par le raidissement de l’académie, en réaction à
l’émergence de styles variés, parfois enracinés dans la campagne
idéalisée que Schinkel taquinait déjà –
Art & Craft – parfois tentés par les ténèbres médiévales –
expressionisme allemand – parfois tournés vers des recherches formelles d’inspirations florales et animales –
Art Nouveau français et belge , Modernisme catalan – et, plus rarement, engagés dans l’expérimentation pragmatique des matériaux nouveaux, au service de besoins nouveaux –
École de Chicago.
Dans le prolongement de l’éclectisme, ces mouvements se croisent, se
rencontrent, se mêlent, en sorte qu’il ne fut pas très difficile, pour
les historiens militants de l’AM™, de les considérer en bloc comme les
précurseurs de l’heureux évènement.

Frank Lloyd Wright, Eglise Unity Temple, Oak Park, Illinois, Usa, 1904 1907
Frank Lloyd Wright (1867-1959) deviendra un architecte moderne, parmi
les trois ou quatre plus grand du siècle. Mais au tout début du siècle,
Wright reste attaché à certaines valeurs du classicisme –
Unity Temple, 1904 – il des tentations précolombiennes –
Maison Hollyhock, 1917 – des complicités japonaises –
Hôtel Imperial de Tokyo, 1923 – et une indéfectible fidélité à la veille cabane des pionniers américains –
Maison Wright, 1889.

Maison Dana,1900 Maison Robie, 1908
Son entrée en modernité se fait par l’entremise d’un type nouveau, qu’il développe de 1900 à 1909, la «
maison de prairie ».
En moins de dix ans, il réalise une dizaine de pièces maîtresses. La
maison Dana nous montre tout ce qu’il doit au romantisme : plan
dissymétrique ; profondeur de champ ; tension entre l’horizontale et
l’assemblage de volumes variés. La maison Robie montre ce qu’il en fait :
les horizontales s’étirent ; les porte-à-faux se projettent en avant.
Les toits en pentes, qui singularisaient efficacement chaque volume de
la maison Dana, deviennent passablement encombrants dans la maison
Robbie : s’ils étaient vus en pignons, ils entraveraient le glissement
des horizontales. Wright les conçoit à quatre pans, qu’il abaisse autant
qu’il peut ; les photographes finissent le travail, en descendant
l’objectif, pour ne plus montrer que les sous-faces des toitures. Á
l’intérieur de la maison Robie, les pièces s’assemblent plus librement,
tel qu’aucune ne puisse paraitre au centre de la composition. On peut y
voir l’accomplissement du projet romantique. Les modernes y voient les
prémisses du plan libre. Bien sur, Frank Lloyd Wright est trop
pragmatique pour ne pas devenir moderne. Mais dans une autre histoire du
monde, il aurait été le maître absolu d’un siècle néoromantique.
1920 – Ludwig Mies van der Rohe et la Renaissance
C’est dans les années vingt que les architectes modernes apparaissent, militants intransigeant d’une «
table rase
» qui ne devrait rien au passé, et tout, à la résolution pragmatique
des problèmes du monde moderne. Ce programme radical révèle l’AM™ comme
un Dieu Jaloux, exclusif de tous les autres. L’AM™ se bât sur deux
fronts. Les modernes attaquent leurs ennemis, les académistes, qui leur
rendent coup pour coup. Mais ils se préservent aussi de ceux qui
auraient volontiers été leurs amis, les héritiers de l’éclectisme, les
romantiques curieux de tout, ouverts à toutes les aventures : «
vous
faites dans le genre moderne, comme c’est intéressant, ça ressemble
furieusement à la casbah d’Alger, que j’ai visitée l’an dernier, moi
même je travaille à la manière provençale, vous aimez la Provence
n’est-ce-pas, nous allons nous entendre… » Et bien non, les modernes refusent les compromis, tout comme les chrétiens refusaient le syncrétisme antique : «
il y a un seul dieu, c’est le notre ! ». Á tout prix, ils doivent faire le vide entre eux et les académistes.

Bruno Zevi, Le langage moderne de l’architecture Mies, Maison de campagne en briques, 1923
Le plan abstrait de Schinkel est radicalement débarrassé des vieilleries qui l’encombraient. La «
table rase
» est servie. Surtout, la boite est brisée. Á ce propos, le plus simple
est d’entendre Bruno Zevi, un des meilleurs propagandistes de l’AM™ :
la maison était une boite étouffante, un terrible sarcophage ; on
l’ouvre ; on fait glisser les plans ; la lumière entre par toutes les
failles ; on libère l’homme de sa prison… La «
maison de campagne en briques » de Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) initie ce programme.

Pavillon de Barcelone, 1929 Maison Farnsworth, 1946 1951
La grande trouvaille de Mies van der Rohe sera le «
plan libre
» : la structure est déliée de l’enveloppe, comme dans la colonnade de
Perrault. C’est une résolution nouvelle et particulièrement élégante du
problème de Brunelleschi : la structure géométrique du volume est
marquée par la trame régulière des poteaux ; le montage perspectif est
assuré par les murs déliés de l’enveloppe. Brunelleschi avait besoin de
deux volumes : un grand volume pour que l’Homme se tienne au centre ; un
petit pour qu’il se voit au centre, en reflet du premier volume.
L’homme de Mies n’est plus au centre, il se déplace librement dans deux
structures superposées, la trame régulière des poteaux,
montage géométrique, et l’assemblage pittoresque des cloisons,
montage perspectif.
En installant deux logiques dans le même volume, Mies n’a plus besoin
des deux volumes assemblés en abîme de Brunelleschi. Il y revient dans
sa carrière américaine, en particulier dans la mise en abîme des deux
plateaux de la maison Farnsworth. Mies avait quitté l’Allemagne pour les
États-Unis en 1938. Avant ou après lui, d’autres architectes modernes
fuient l’Allemagne nazie, par conviction ou par pragmatisme. Ils sont
accueillis à bras ouverts dans un Amérique encore impressionnés, en ce
temps-là, par le prestige de la vieille Europe. Avec leurs confrères
américains, ils constituent le «
Style International »,
achèvement triomphal de l’AM™. Mies reviendra progressivement aux boites
de Brunelleschi, désormais fermées par du verre, dont la dernière est
construite à Berlin, dans le pays qu’il avait dû quitter, contraint et
forcé. En apparence, le travail de Mies sur le plan libre rejoint celui
de Wright sur l’architecture organique. Mais Wright est romantique, Mies
est platonicien. Il croit, sinon à la justice du Dieu de la
Renaissance, du moins à la justesse du Dieu de l’Industrie. Á sa suite,
l’AM™ apparaitra comme un retour constant aux Idées et aux Catégories,
désormais vieillies, de la première Renaissance.
1940 – Le Corbusier et le Maniérisme
La «
table rase » des années vingt excluait toute référence au passé
[13].
Les architectes allemands et américains imaginaient l’AM™ comme une
réponse objective aux problèmes du temps, dans l’esprit d’un temps
pragmatique. Ils bénéficiaient d’une heureuse conjonction entre une
technique constructive pragmatique,
la structure poteaux/dalles, et un projet architectural idéal,
le plan libre.
Ils pouvaient croire que la technique est à jamais libératrice. Cette
innocence n’est plus possible après que les techniques des années
d’après-guerre privilégient, en Europe, les casiers
refends/dalles, dont sont issues les «
cages à lapins
» qui sont construites, en masse, et à toute vitesse. La technique
contraint le plan qu’elle avait préalablement libéré. Les modernes
s’attèlent à la tâche idéalement pragmatique qu’ils se sont assignés.
Mais tandis qu’ils remplissent méticuleusement les cages, entre dalles
et refends, ils mesurent l’écart entre leur pragmatisme affiché et leur
l’idéalisme sous-jacent. Les modernes se découvrent un passé, à bien des
égards plus noble et plus juste que leur présent !
[14]
Ils portent une attention renouvelée à l’œuvre d’un des pionniers de
l’AM™, architecte franco-suisse dont les bizarreries sont désormais
mieux comprises.

Le Corbusier, les quatre compostions
Le Corbusier (1887-1965) est un architecte moderne de même calibre
que Frank Lloyd Wright et Ludwig Mies van der Rohe. Mais il n’a jamais
imaginé l’architecture comme une simple réponse pragmatique aux
problèmes du moment, et n’il n’a jamais douté avoir un passé. Il a été,
avec Mies, l’inventeur du plan libre, et son théoricien le plus
explicite. Mais il ne l’a jamais parfaitement réalisé que dans un seul
projet, qui n’apparait que comme une variante, parmi d’autres, du
problème éternel de la boite fermée. Il en explore toutes les solutions :
1) l’assemblage romantique de boites variées –
maison La Roche, 1923 – 2) la boite fermée de la renaissance –
villa à Garches, 1927 ; 3) le plan «
libre » dans sa boite –
Villa à Carthage, 1929 – la boite creusée derrière les colonnes du classicisme –
Villa Savoye, 1931…

Villa Carthage 1928
Un premier projet pour la villa Carthage (1928) montre toutes les
difficultés et tous les bonheurs qu’il peut avoir à concilier ces
différents aspects de la boite : c’est un assemblage romantique, ou deux
boites distinctes paraissent s’encastrer ; c’est aussi un pur
parallélépipède simplement percé ; c’est un plan libre, marqué par une
trame régulière de poteaux, qui traversent tous les étages mais ne se
révèlent qu’en toiture ; c’est enfin une colonnade néo-classique, qui
occupe la partie la plus haute de la plus longue des façades. Comme tout
maniériste, Le Corbusier rejoue indéfiniment la même partie en
explorant tous les coups possibles. Il est, comme Michel-Ange qu’il
admire, un génie inclassable. De 1940 à 1960, il développera ses plus
grand projets maniéristes : la maison du docteur Currutchet à Buenos
Aires (1949) ; l’Unité d’Habitation de Marseille (1952) ; le siège de
l’Union des Filateurs à Ahmedabad (1954). Dans le même temps, il se fend
de quelques chef d’œuvres baroques : la chapelle de Ronchamp (1953) ;
le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (1959) ; le palais de l’assemblée
de Chandigarh (1961)… Même motif et même punition que Michel-Ange.
1960 – Louis Kahn et le Baroque
Le rêve naïf d’une architecture platonicienne et pragmatique, déjà
largement ébranlé dans les années cinquante, se brise définitivement
dans les années soixante. Les «
cages à lapins » sont livrées ! Les «
lapins »
sont d’abord ravis de leurs cages, plus confortables que les taudis et
les bidonvilles qu’ils viennent de quitter. Mais très vite, ils
soulèvent un lièvre : les grands ensembles qu’on leur impose se révèlent
plus épouvantables que sublimes. C’est ça, la modernité ? Les
académistes ricanent, comme d’habitude. Les modernes de stricte
obédience se prétendent «
trahis » par ceux-là même qu’ils
adulaient, les ingénieurs et les commanditaires. En masse, de nouvelles
avant-gardes contestent les masses, et rejettent les blocs, en bloc.

Institut indien de management, 1962-1974 Centre des arts britanniques, 1969-1974
Les années soixante vont voir fleurir des mouvements critiques
variés, de toutes natures : le Team Ten (1960), groupuscule
révisionnistes du mouvement moderne ; Archigram (1961), coalition
d’amoureux de la bande dessinée et des films de science-fiction ; les
Gris (1966), conglomérat postmoderne qui manipule les références
historiques avec ironie ; les Blancs (1969), cartel néo-moderne
prolongeant les jeux maniéristes au-delà des limites convenues ; les
Régionalistes Critiques ; les Historicistes ; les Reconstructeurs de la
Ville Européenne ; etc. Peu ou prou, tous en viennent à citer Louis
Kahn (1901-1974). Ainsi, Robert Venturi, chef de file des Gris,
promoteur «
de l’ambiguïté en architecture », cite 20 fois Mies
van der Rohe et 28 fois Le Corbusier, presque toujours en style
indirect et presque toujours à charge, tandis que Kahn est cité 31 fois,
presque toujours en citations directes, entre guillemets, et toujours
en faveur des thèses de l’auteur. «
Louis Kahn dit : « … » »,
dit Venturi. Pour lui comme pour tous les autres contestataires, Kahn
annonce des temps nouveaux. Il referme la boite de Pandore ouverte pas
les modernes. En refermant les boites, il peut fragmenter leurs
assemblages, à la manière de la villa Adriana. En confirmant les
symétries ébauchées avant lui, il recentre les plans. En redescendant
des murs épais jusqu’au sol, il restitue leur fonction porteuse. En
resserrant les béances entre les murs, il retrouve les fenêtres. En
gonflant les plafonds, il élève les toits jusqu’à la lumière. Il
recouvre la grandeur et la monumentalité de l’architecture romaine…

Capitole de Dacca, 1962 Synagogue Hurva à Jérusalem, 1968, d’après Ching
Mais aux yeux des modernes, Kahn reste des leurs. Ses petites
fenêtres sont encore des failles entre les murs, comme le sont celles de
la «
maison de campagne en briques » du premier Mies van der
Rohe. Ses plus grandes ouvertures préservent, en arrière-plan, des
murs-rideaux de même facture que ceux du second Mies. Souvent, les plans
de Kahn apparaissent comme des versions contractées, tendues, et
sublimes, du bon vieux «
plan libre ». Pour les partisans de l’AM™, Louis Kahn est incontestablement moderne !
Il fallait à ses temps troublés une référence incontestable, qui
puisse être cité, aussi bien, à charge et à décharge du mouvement
moderne. Louis Kahn n’est pas Baroque. Mais par l’ambiguïté de son
propos, par les rais de lumière qu’il fait descendre du ciel jusqu’aux
entrailles de ses bâtiments, par l’ombre profonde qu’il génère, il
reconstruit la grotte où vont se délecter les baroques de tout acabit.
Après que Louis Kahn a physiquement mis en terre AM™, les postmodernes
croient pouvoir historiquement l’enterrer…
1980 – Jean Nouvel et le Classicisme
Dans les années quatre-vingt, une césure profonde distingue la
production de masse de l’architecture savante. Certains promoteurs,
inquiets des réactions que suscite l’architecture moderne, vont se
tourner vers une version édulcorée du postmodernisme des Gris. Des
architectes médiocres vont répondre à leurs attentes, dans un genre qui
se révèle trop «
facile » pour être savant. Le succès
commercial du postmodernisme va le discréditer aux yeux des élites
architecturales. Des architectes, brièvement tentés par le propos des
Gris, vont pressentir l’impasse et retourner à leurs premières amours.
L’AM™ ressort du puits dans les années quatre-vingt, en robe de mariée,
d’autant plus désirable aux yeux des architectes qu’elle semble avoir
perdu la bataille auprès du public.

Superstudio, A Natalini, Il monumento continuo, O Pais d’O sole, 1969
La refondation de la modernité méritait un retour aux origines. Mais un mouvement qui se proclame sans «
passé antérieur »
à lui-même ne peut, en toute logique, revendiquer la moindre cabane
primitive qui aurait précédée son avènement. Il est privé, à jamais,
d’une redécouverte de sa préhistoire. Par définition, l’AM™ n’a pas de
préhistoire. Les seules références extérieures à elle même que l’AM™
peut légitiment revendiquer sont : 1) le contexte de son avènement, la
révolution industrielle ; c’est ce que vont faire les rois du boulon et
de l’écrou, Foster et Rogers… à la suite d’Archigram ; 2) une
architecture intemporelle, abstraite, essentielle ; c’est ce que fera
Jean Nouvel… à la suite de Superstudio, qui couvrait le monde d’une
grille systématique, sans épaisseur ni procédé constructif apparent.
Comme il faut quelques clefs anglaises pour faire tenir les voiles
latines de Superstudio, et quelques concepts français pour donner de
l’allure aux mécanos anglais, les deux courants vont se rejoindre.

Jean Nouvel, Fondation Cartier, Paris, 1991
Jean Nouvel (1945-) a eut quelques tentations postmodernes : une
colonne dorique suspendue par-ci ; un fauteuil en velours rouge par-là…
Mais il ne révèle son importance que par son retour à l’AM™, comprise
comme un retour au classicisme. Là où Claude Perrault aligne une seule
façade derrière une seule colonnade, là où Mies van der Rohe accroche un
seul mur-rideau en avant d’une seule file de poteaux, Jean Nouvel
double, triple, quadruple ses lames de façades superposées. Il n’est ni
le seul, ni le premier. Mais au regard de projets précédents, comme le
très baroque musée Georges Pompidou (Piano & Rogers 1971), il
contient l’inflation des peaux superposées dans une rigueur qui, à
nouveau, fait honneur au génie français. Le néoclassicisme des peaux
feuilletées définit le nouveau territoire de l’AM™ : en avant des peaux,
au dehors, il y a une ville que les architectes ne maîtrisent plus ; en
arrière des peaux, au-dedans, il y a des bureaux et des logements que
les architectes ne contrôlent plus ; tout se passe désormais dans la
mince pellicule qui sépare deux mondes étrangers.
2000 – Adolph Loos et le Roman Cistercien
Le néoclassicisme des peaux épaisses n’est qu’une des tendances de
l’architecture contemporaine, qui n’a rien oublié de son propre passé.
Tous les mouvements inaugurés depuis 1900 ont droit de cité dans
l’architecture savante du moment présent, toutes les inventions
nouvelles y sont bienvenues, pour autant qu’elles respectent certains
interdits fondateurs du mouvement moderne.
Le premier interdit, le plus explicite, concerne la cohérence d’un
projet : si un certain effet est recherché, rien ne doit entraver cet
effet. Ce principe est amendé par le droit à l’ambiguïté, tel qu’il a
été revendiqué par Robert Venturi : un concepteur peut contredire un
effet attendu, pour autant qu’il énonce cette contradiction comme un
effet recherché. Mais dans l’enseignement de l’architecture, cette
pratique est considérée avec réserve. On suppose, souvent à juste titre,
que l’ambigüité d’un dessin d’étudiant relève plus de la maladresse que
d’un projet délibéré.
Le deuxième interdit, rarement avoué, concerne la cohérence d’un
courant : un architecte qui adhère à un courant de l’architecture
contemporaine évite légitimement ce qui entraverait cette tendance. Un
architecte moderne de stricte obédience, visant le plan libre, évitera
la symétrie, les murs porteurs, les plafonds voutés… Dans l’enseignement
et la pratique de l’architecture, le concepteur aura tendance à
présenter comme un acquis universel ce qui relève de sa propre tendance
[15].
Le troisième interdit, le plus profond, le plus durable, le seul qui
soit universel dans l’architecture savante, est la prohibition de
l’ornement. L’architecture occidentale a déjà connue cet interdit, à
l’époque où les moines cisterciens décidaient de construire leurs
églises sans apprêts. Mais c’était, à leurs yeux, comme à ceux des
prélats gras et roses dont ils voulaient se distinguer, une pure
mortification. Il revient à Adolph Loos de montrer, en 1908, les
plaisirs du dénuement architectural.
«
Ornement et Crime » est un article élitiste, teinté par un
racisme daté qui, aujourd’hui, mérite explication, sinon justification.
Pour Loos, si «
le Papou tue ses ennemis et les mange », s’il est «
amoral
», c’est parce qu’il serait, comme les paysans de nos campagnes, comme
les dévots de nos églises, comme les enfants que nous avons été, à un
stade antérieur de l’humanité. Le Papou qui se tatoue «
n’est pas un criminel », ni l’enfant qui va «
crayonner les murs de symboles érotiques. » Ils ne méritent pas notre réprobation morale, puisqu’ils n’ont pas atteint notre maturité. Si Loos «
prêche pour l’aristocratie », pour «
l’homme qui se situe à la pointe de l’humanité », il comprendra fort bien «
le cafre qui entretisse d’ornement une étoffe » et il «
soulèvera son chapeau en passant devant une église. »
Son dédain aristocratique ne se confond ni avec le mépris, ni avec la
haine. Loos, comme les colons éclairés par l’humanisme, n’exclu pas, et
espère, que nos «
inférieurs » puissent, un jour prochain,
rejoindre notre état de haute culture. Pour reprendre la construction
intellectuelle de Loos, son racisme n’a pas atteint l’état de haute
barbarie que nous lui connaissons aujourd’hui. Notre seule manière de
sauver Loos d’une abjection qu’il n’a pas commise, et qu’il n’appelle
pas à commettre, est de lui appliquer le même dédain qu’il exerce à
l’encontre de ses contemporains «
arriérés ». Et il nous faut bien sauver Loos, puisque son élitisme est la maladie infantile de notre humanisme, et que son art est «
l’enfance » du notre.
«
Ornement et Crime », délié de ce contexte désormais
haïssable, est construit à partir d’une tautologie : si l’ornement est
défini comme ce qui n’est pas nécessaire, l’ornement est accessoire. Ce
qui s’ensuit n’est pas tautologique : l’accessoire est un gaspillage de
travail, un gaspillage de matériel, un gaspillage de capital, un
gaspillage humain ; le gaspillage est moralement condamnable dans une
société de haute culture… Plus sérieusement encore, en mettant les
structures à nu, «
l’absence d’ornement a élevé les arts à une
hauteur jusqu’alors insoupçonnée. […] Nous sommes devenus plus fins,
plus subtils. Les hommes qui vivaient en troupeaux devaient se
distinguer les uns des autres par des couleurs ; l’homme moderne utilise
son vêtement comme un masque. Sa personnalité est si puissante qu’elle
n’a pas besoin de s’exprimer dans ses habits. L’absence d’ornement est
un indice de force spirituelle. L’homme moderne utilise à sa guise les
ornements des cultures antérieures et étrangères. Son propre pouvoir
d’invention se concentre sur d’autres objets. »
Tout est déjà dit, en 1908, de la production architecturale actuelle :
1) pour satisfaire les gouts du vulgaire, il est possible de prolonger
l’éclectisme,
d’utiliser à sa guise les ornements des cultures antérieures et étrangères
; c’est ce que font encore un grand nombre d’architectes postmodernes,
et c’est ce qui se fait, en masse, dans le production du cadre bâti qui
échappe au contrôle des architectes ; 2) pour satisfaire certaines
élites et pour exprimer l’esprit du temps, il faut prohiber l’ornement
dans l’architecture savante.
On pourrait interpréter cet interdit d’un point de vue sociologique, dans l’esprit «
de la distinction » de Bourdieu : si la haute culture est un «
capital culturel
» que se transmettent les élites, si elle a pour fonction d’entraver
l’ascension sociale des plus pauvres, la haute culture doit
nécessairement se distinguer des goûts vulgaires ; dans cette
perspective, l’espoir d’une haute culture partagée par tous est une pure
fiction. Cette théorie, encore crédible dans l’Europe des années
soixante, s’avère incapable de décrire le monde actuel : les élites et
les «
peoples » ne brillent plus particulièrement par leur haute culture ; si distinction sociale il y a –
et distinction sociale il y a probablement
– elle ne passe plus par la compréhension des arts majeurs, et moins
encore par le goût de l’architecture savante. Au contraire, il est très
surprenant que subsiste
encore une architecture savante, alors
même qu’elle a été reniée, dans les années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix, par des élites qui se vautraient, en règle générale,
dans un luxe ornemental qui aurait fait frémir Adolph Loos. Le retour
des élites à l’architecture savante, tout juste sensible au début du
vingt-et-unième siècle, fait plus partie du mystère que de son
explication.
On peut également interpréter l’interdit ornemental comme un effet
interne à la discipline : si l’absence d’ornement a effectivement «
élevé les arts à une hauteur jusqu’alors insoupçonnée », on peut comprendre qu’une petite élite d’architectes, «
devenus plus fins, plus subtils
», ne veuille pas y renoncer, quand même son échec à réformer le monde a
été mille fois démontré. On peut en particulier comprendre le déni de
réalité des architectes : ils continuent de voir l’architecture moderne
comme une extraordinaire nouveauté, qu’il suffirait encore et toujours
de «
faire comprendre » à un monde attardé ; après l’indéniable
succès de l’architecture moderne dans les années quarante à soixante,
ils n’ont pas pu comprendre le renouveau régionaliste et ornemental
autrement que comme une régression ; et ils ne peuvent pas comprendre
les plus récents succès de l’architecture moderne autrement que comme un
retour à la normale. Si l’interdit ornemental, posé comme acquis
indépassable de la discipline, explique assez bien les comportements
névrotiques des architectes, la mise en pratiques réelles de l’interdit
est très surprenante : il s’agit moins d’une quête passionnée que d’une
norme sociale ; et elle vise moins l’ornement en général que l’ornement
classique en particulier. Depuis longtemps, les détails d’architectures
les plus maniérés, et les plus encombrants au regard de la clarté
structurelle, on droit de cité dans l’architecture savante. Á vrai dire,
n’importe quel «
accessoire » peut être utilisé –
brise-soleil, vantelle, grille, parement
– dès lors qu’il ne s’apparente pas à l’architecture classique, et aux
architectures régionales qui en sont dérivées. Le refus de l’anecdote,
qui a démontré son efficacité plastique dans l’architecture moderne de
première génération, n’explique rien d’un interdit désormais
anecdotique, de pure convention.
Une interprétation correcte des conventions culturelles peut être
finalement plus efficace pour comprendre l’interdit ornemental. Les
conventions sont prises au sérieux par ceux qui les respectent : dans la
cité grecque, dont le mythe fondateur est l’assemblée des hommes
libres, les citoyens sont régulièrement exhortés à servir la cité, de
toute leur énergie, de tout leur temps et de tous leurs moyens ; il
aurait était très inconvenant qu’ils se tiennent à l’écart de la
politique ; dans la république romaine, dont le mythe fondateur est la
détestation des rois, les empereurs, «
maîtres et dieux », prétendent toujours tenir leurs autorités «
du Sénat et du Peuple de Rome »
; il aurait été très imprudent qu’ils se proclament rois ; dans les
abbayes cisterciennes, dont le mythe fondateur est le retour à la règle
de Saint Benoit, son respect et l’interdit ornemental sont perçus comme
de réelles mortifications ; il aurait été très sacrilège d’y déroger
publiquement. Les formes sont d’autant plus importantes que les
citoyens, les empereurs et les moines, ont à composer autrement leurs
pratiques. Dans une société architecturale dont le mythe fondateur est
l’abolition de l’architecture classique, la plupart des architectes
proscrivent les signes apparents du classicisme, à petits frais, eut
égard aux pratiques actuelles de l’architecture savante. L’AM™ n’a
jamais été abolie que par quelques fous, qui l’ont payé cher, parce que
les architectes raisonnables jugent sincèrement qu’ils en sont les
héritiers. Et dans la société savante des architectes, il est
pratiquement
plus commode de se prétendre encore modernes. Ça n’empêche pas les
architectes contemporains de faire tout autre chose que du plan libre,
ça ne les empêche pas de produire des projets d’inspirations maniériste
ou baroque, ça ne les empêche pas de critiquer et de renouveler
l’architecture, de créer et d’inventer, dès lors que les apparences trop
visiblement classiques sont évitées. Ça ne se fait pas, de paraître
trop romain, ou trop grec, ou trop égyptien ! C’est à la fois une
convention et une croyance, assez légères à porter, au regard de la
liberté qu’elles autorisent. La seule question qui vaille, dans le
dispositif actuel, est celle que Paul Veyne posait à propos des grecs :
les architectes croient-ils à leurs mythes ?
[16]
Ni plus ni moins que les personnes cultivées de la période
hellénistique croyaient aux leurs : ils reconnaissent sincèrement à
l’AM™ certaines valeurs générales ; ils y font dévotions ; et ils
vaquent à leurs affaires.
Leurs comportements maniaco-dépressifs, alternance d’enthousiasmes et
d’accablements, leurs envolées lyriques et leurs crispations soudaines,
tiennent plus au contenu du mythe qu’au regret de n’y plus croire
autant qu’on le devrait. Ça n’est pas rien, de prétendre fonder sa
pratique sur un interdit élitiste. Ça n’est pas rien, d’être dans le
déni apparent de ce qui a précédé l’AM™. Ça n’est pas rien, de
travailler dans les décombres d’un grand projet social et culturel. Mais
ça n’est jamais aussi essentiel qu’un platonicien peut le craindre.
Très heureusement pour les architectes, comme pour les habitants des
villes bombardées, on peut vivre et travailler sur un champ de ruine.
C’est juste un frisson, de temps en temps, qui nous étreint.
Les architectes contemporains ont à dire et à faire sur la ville. Ils
ont à renouveler leur réflexion sur le logement et les infrastructures.
Ils ont, à nouveau, à s’adresser au monde, en des termes nouveaux.
Depuis qu’ils n’envisagent plus leur adhésion à l’AM™ comme un obstacle
rédhibitoire ou comme une cause sacrée, depuis qu’ils en ont fait une
simple formalité, le monde comprend mieux ce qu’ils disent. Le public,
qui pour un temps assez long avait rejeté l’architecture moderne, se met
à aimer ce qui, aujourd’hui, en tient lieu : il aime le Guggenheim de
Gehry ; il aime la Pyramide de Pey ; il aime l’Institut de Nouvel ; le
public aimera peut être les tours et les toits-terrasses, quand les
architectes auront trouvé de nouvelles solutions à la question du
logement. Le public est adorable, depuis qu’on ne lui demande plus
d’adorer un Dieu Jaloux.
Dans le monde comme il va, il n’est pas sûr que les Lumières puissent
gagner contre l’obscurantisme. Rien n’est moins sûr, à vrai dire. Mais
certains verrous intellectuels ont sautés, qui permettent aux
architectes de prendre part au combat.
Pascal Urbain, 2007